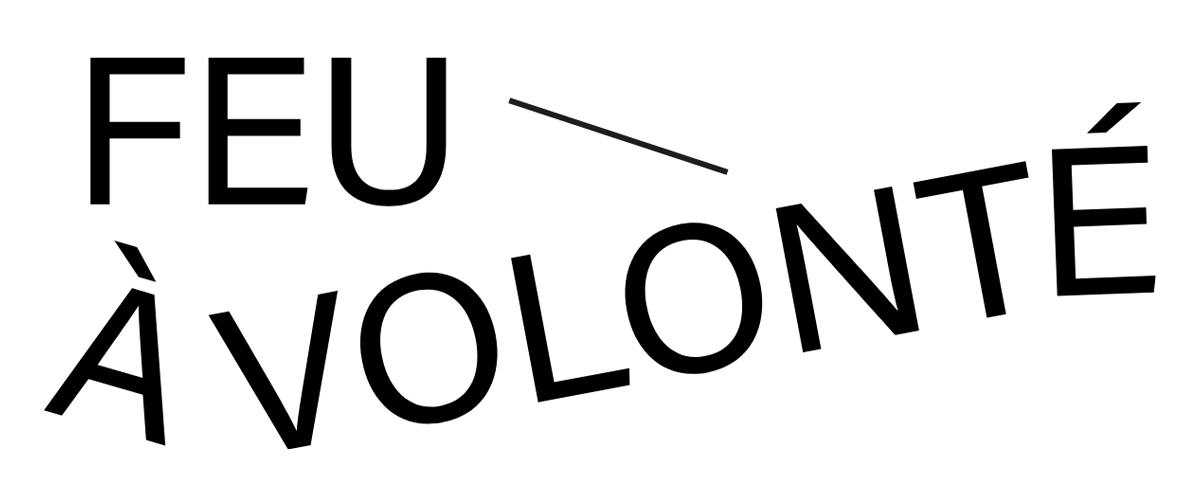Poétique, lumineux et enveloppant, l’indie-folk de l’auteur-compositeur-interprète Matt Tomlinson résonnera dans la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts ce soir à 20 h.
L’artiste anglophone à la voix suave, qui a assuré la première partie de spectacles des sœurs Boulay en 2014, s’est illustré l’an passé avec l’impressionniste Un été en hiver, réalisé par Tim Gowdy (qui a notamment travaillé avec The Barr Brothers et Coral Egan), album francophone qui succédait au EP Ou presque, paru en 2014 et au long jeu Place to Stand en 2012.

L’attachant bohème originaire de l’Ontario, mais résidant à Montréal «depuis toujours», se produira dans le cadre des Week-ends de la chanson Québécor, une série de concerts réalisée en collaboration avec la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française qui valorise — et célèbre — la chanson francophone. Nous en avons profité pour le questionner sur l’apport du français à sa création, idiome qu’il chérit et qu’il a appris dans sa ville d’adoption. Un entretien aussi chaleureux que sa musique, onirique et apaisante, éclat de lumière bienfaisant en pleine morosité hivernale.
Pourquoi avoir voulu créer en français?
C’est un concours de circonstances. Comme j’ai toujours aimé parler français depuis que je vis ici, je me suis dit que ce serait l’fun. Une toune de mon album anglais avait été traduite, l’un de mes amis en avait travaillé l’adaptation avec moi. Je n’avais toutefois pas vraiment de perspective à savoir si c’était bon ou non, car, ce qui est étrange, c’est que même les Français peuvent parfois être confus dans leur langue. Recevoir du feedback extrêmement différent d’une personne à l’autre, c’est mélangeant.
Que signifie pour toi le fait de participer au WDCQ?
Ça me touche beaucoup parce que j’ai déménagé à Montréal pour devenir artiste. Les hommes d’affaires étaient nombreux dans ma famille, mais j’étais attiré par la vie culturelle, par la ville. J’ai grandi en campagne. Je n’avais pas de voisin! C’était très beau, mais la culture attisait ma curiosité. Pour un gars qui vient de la campagne ontarienne, qui a eu des jobines, qui est parti de rien, qui a appris le français, jouer en français à la Place des Arts, c’est particulier en raison de mon bagage. Montréal compte beaucoup, c’est l’endroit où j’ai appris la langue.
Tu as appris le français alors que tu aurais pu bâtir ta carrière qu’en anglais.
Ma musique est comme une réconciliation des langues. Je ne veux pas nécessairement faire ma carrière en français, mais c’est l’fun de créer de l’art qui reflète la réalité montréalaise. Mon prochain disque sera peut-être en franglais, qui sait? Je ne veux pas cesser de chanter en anglais, mettre cette langue de côté, même si je n’ai pas toujours aimé la culture de laquelle je suis issu — je proviens d’une lignée de royalistes. Les langues m’intéressent, je veux un dialogue, je crée dans un esprit de partage. En plus de la langue, j’ai découvert l’histoire de notre pays. Je suis arrivé à Montréal juste avant le référendum de 1995. On me disait: «Man, you’re going the wrong way», alors que je tripais en vivant cette effervescence, auprès de ma blonde. J’ai suivi mon instinct et j’ai eu un coup de cœur pour Montréal. Dès mon arrivée, j’ai croisé des gens vraiment friendly. Les gens ici sont très à l’aise. L’architecture et l’histoire, qui m’intriguait, m’ont aussi beaucoup touché d’emblée. Je sentais que quelque chose se passait.
As-tu éprouvé une certaine dualité identitaire?
Dans mes cours au secondaire, on a souvent parlé de littérature canadienne, qui aurait deux thèmes majeurs: la nature et l’identité. Ça me rejoint vraiment puisque j’ai été élevé sur un terrain de 100 acres et que j’ai voulu savoir qui je suis. Ici, je respirerais un peu mieux. Un autre côté de ma personnalité, plus impressionniste, a surgi. J’ai aimé ça. Et j’étais curieux de découvrir l’Autre.
Crées-tu spontanément dans les deux langues?
Pas du tout ! C’est vraiment l’adaptation de ma chanson qui a tout démarré. Des idées de chansons en français ont germé en moi. Un groupe d’amis et moi avons commencé à créer des tounes, comme ça. Presque tout l’album Un été en hiver a été coécrit avec le Parisien Michael Dudemaine, qui est devenu un collaborateur et qui vibre, comme moi, à Montréal. Les deux, on n’a pas tripé chez nous. C’est un Français qui ne boit pas de vin. On avait des perspectives communes. Ça permettait d’écrire ensemble en partageant une certaine base. Il écrivait souvent, mais on cogitait ensemble. Durant le processus du brainstorm, je formulais davantage de phrases en français à l’oral que sur papier. C’est un travail à quatre mains qu’on a ensuite mis en musique.
Comment décris-tu ta musique?
À la blague, je la qualifie de wizard rock. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, mais c’est de l’indie-folk au côté cinématographique. Je n’ai pas d’étiquette, je suis vraiment indépendant. J’ai créé de la musique de film par le passé, et ça teinte ma création. J’ai travaillé sur des documentaires aussi.
Comment le réalisateur Tim Gowdy, alias Ti-Hawk, a-t-il influencé l’album?
Il s’est énormément impliqué. D’une certaine façon, c’est un band déguisé en projet solo. La collaboration m’inspire. On avait coréalisé un album de John Davis, avec qui j’ai fait une tournée au Canada, sur lequel je jouais aussi de la batterie. Ti-Hawk et moi avons cliqué, et on s’est liés d’amitié. Avant qu’il réalise Un été en hiver, j’avais tout effectué moi-même sur mon premier album — jouer des instruments, le réaliser — avec peu d’argent, retiré dans le bois ; c’était une période flyée. Après, je suis revenu à la civilisation en me disant : «Musique, man !»
En spectacle à la Salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, le vendredi 22 janvier à 20 h.