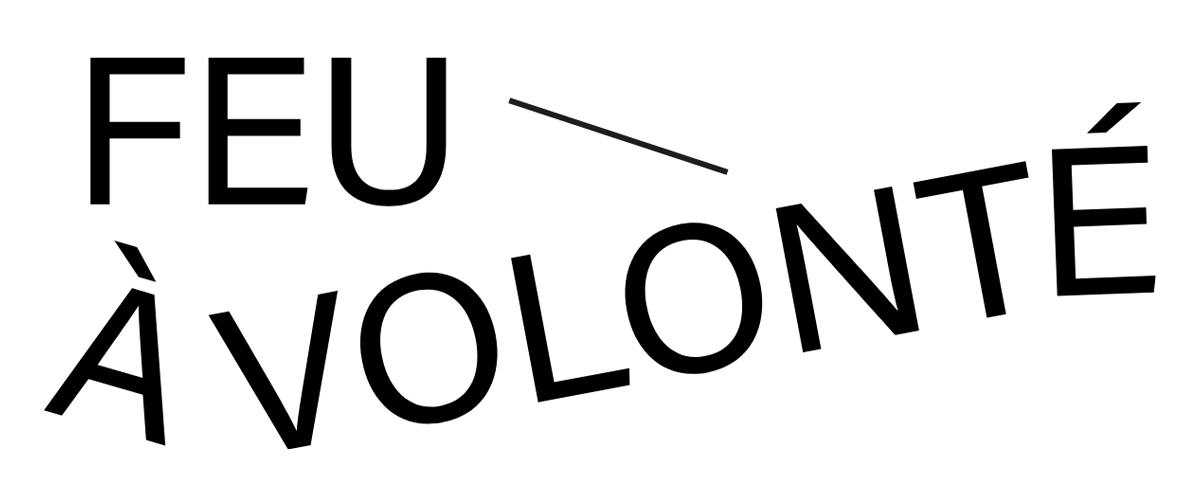Gorillaz
Gorillaz
Plastic Beach
Parlophone
Grande-Bretagne
Note : 8.0/10
« Pop! » C’est le son que fait Plastic Beach, le dernier disque de Gorillaz, lorsqu’il se décolle de son esthétique boîtier. Sur la pochette, on peut voir l’œuvre d’ingénieux graphistes avec un tableau conçu à l’ordinateur d’une île artificielle sous forme de champignon nucléaire qui flotte sur un océan déshumanisé. À l’intérieur du lecteur de disques, le « pop » se continue de belle façon avec un excellent mélange de hip-hop, d’orchestration orientale et d’électro que seuls des personnages animés et hallucinés peuvent dessiner avec autant de charme.
C’est pour une troisième fois que Murdoc, 2D, Noodle et Russel reprennent vie dans leur rôle de super groupe virtuel et cela pour satisfaire les imaginaires visuels et auditifs de l’ex-membre de Blur, Damon Albarn, et du dessinateur de la bande-dessinée Tank Girl Jamie Hewlett. Le duo ne revient pas avec le même schéma musical que celui de son album précédent, Demon Days et n’offre rien qui ressemble aux expérimentations de son premier opus éponyme. Les simples à succès comme Clint Eastwood et Feel Good Inc n’y sont pas non plus présents, au grand bonheur de toutes les seize pièces bien travaillées de Plastic Beach. Cette galette est un album concept qui ne peut s’écouter que dans son œuvre intégrale. Ainsi, les chansons se suivent et se répondent parfaitement l’une après l’autre sans jamais s’éclater individuellement. Bien sûr, certaines sortent du lot avec des sonorités plus intéressantes mais ce n’est pas au dam des autres.
Avec une introduction orchestrale d’au moins une minute, Gorillaz surprend et intrigue l’auditeur comme si d’un bateau, un observateur pressentait la terre s’approcher à l’horizon. Le rappeur Snoop Dogg est le premier à rompre le silence vocal en clamant de son vibe funky « Gorillaz and the boss dog, planet of the apes » dans Welcome to the World of the Plastic Beach. Synthétiseurs et claviers juteux abondent dans cette pièce sous fond d’électro-pop. Ne s’éloignant jamais de la surprise, la troisième pièce White Flag débute avec une parade solo d’une minute de l’Orchestre National libanais pour la musique orientale pour finalement se joindre à un duel hip-hop entre les rappeurs Kano et Bashy.
Rhinestone Eyes, rare pièce à n’avoir aucun invité spécial, est le rêve lucide d’une balade nocturne en ville au cœur de rues habitées par des discothèques électroniques colorées. Les synthétiseurs jouent ici le rôle de grands faisceaux lumineux qui aveuglent l’auditeur jusqu’à lui faire comprendre le sens des paroles. Jamais Albarn n’a sonné aussi mélancolique et passionné sur des paroles de lunatiques. Le premier simple Stylo suit avec son hymne aux groupes new wave comme New Order et au disco synthétisé des années 80. Bobby Womack utilise sa voix édifiante pour construire une trame sonore répétitive sur laquelle Mos Def improvise quelques passes de rap. Redondante, Stylo a son charme lorsqu’elle est écoutée avec le reste de l’album mais, à elle seule, elle est un simple très ordinaire.
En plein centre de l’album, Glitter Freeze exploite l’électronique avec une montée instrumentale qui n’est pas sans rappeler la progression de vieilles chansons rock comme One of These Days de Pink Floyd. Après cet ovni musical, la troupe animée ralentit son tempo et tente des expérimentations avec des invités de tout genre comme le chanteur de Velvet Underground, Lou Reed, et le guitariste et bassiste des Clash, Mick Jones et Paul Simonon. Toutes aussi alléchantes, ces pièces révèlent des accents pop qui réussissent à atteindre l’effet désiré, soit d’hypnotiser son auditeur dans l’aventure que raconte Plastic Beach.
Gorillaz donne à l’artificiel une forme musicale qui, ironiquement, s’emprunte à l’une des meilleures pop du moment. Damon Albarn réussit encore le pari qu’il a débuté en 2001 en créant le groupe virtuel le plus populaire au monde. Plastic Beach aurait facilement pu tomber dans la pop facile mais il a plutôt un effet dévastateur pour les oreilles qui sont prêtes à s’imbiber de toxines électro-chimiques.